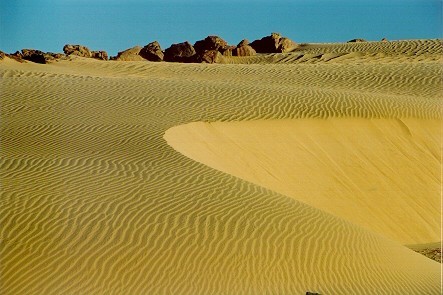| CULTURE |
|
Le désert algérien
dans tous ses états
|
|
|
Nos vertes campagnes
connaissent le panneau de signalisation représentant une
vache dans un triangle cerné de rouge. Depuis mercredi, le
Museum d’Histoire Naturelle a orné son entrée
d'une version avec un dromadaire. C'est le signe -décalé-
de l'exposition "Saharas d'Algérie". |
 Cet écureuil utilise sa queue pour se protéger du soleil. (Photo D.R.) |
La salle suivante,
tendue de grandes bâches blanches, fait la part belle à
la faune et la flore du Sahara algérien. La qualité
pédagogique des différentes présentations et
animations facilite grandement la compréhension. Les subtilités
développées par la nature pour maintenir des êtres
vivants dans cet environnement hostile sont en effet innombrables. Figurent au programme renards, scorpions, vautours, serpents, scarabées, gazelles et, bien sûr, dromadaires. Les végétaux sont eux majoritairement des buissons, équipés pour économiser au maximum l'eau si précieuse. |
|
C'est le peuple touareg qui est ensuite à l'honneur.
Leur mode de vie est exposé de façon très
convaincante, aux sons des instruments de musique locaux : la
flûte (tazammart), le tambour (tinde),
la vièle (imzad). Et l'on apprend que ce sont
les femmes qui possèdent la tente, donnent leur nom aux
enfants et leur enseignent l'écriture, la poésie
et la musique. |
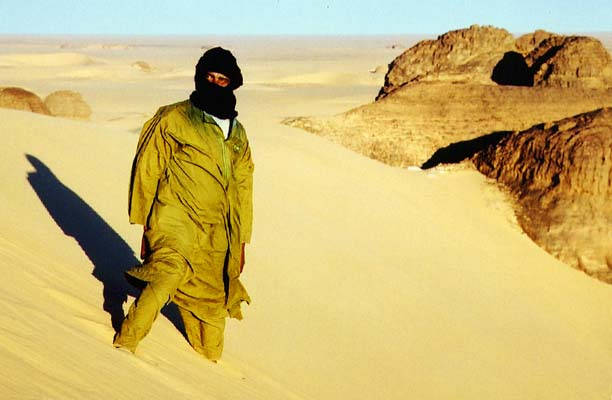 Les touaregs sont indissociables du Sahara. (Photo D.R.) |
|
La dernière partie de "Saharas d'Algérie"
est consacrée à l'exploitation pétrolière
du désert. La réaction d'une petite fille en entrant
dans la salle est saisissante : "là, c'est un
garage !". On la comprend. De vieux pneus de camion,
un bidon rouillé et cette odeur d'hydrocarbures tellement
familière dans nos métropoles. Sébastien
Raffaelli |